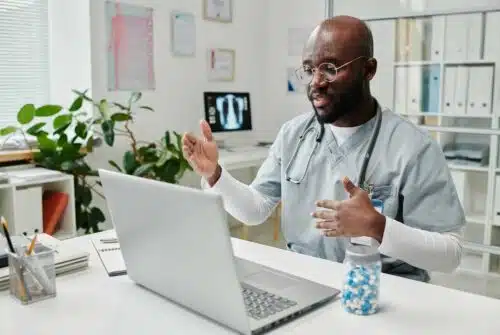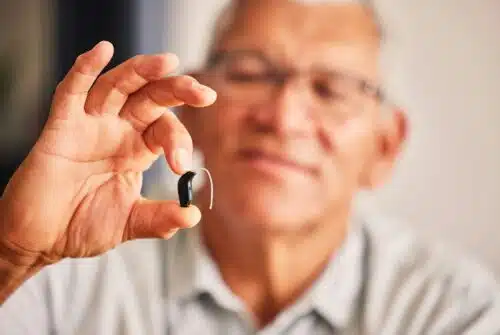Bien-être
La popularité croissante de la chirurgie esthétique en Tunisie s’explique par son attractivité en tant que destination médicale tout compris. Les patients étrangers et notamment
Objet composé de métaux (bronze, cuivre…) et de minéraux (quartz, améthyste…), l’orgonite est associé de façon précise au sein de la résine époxy (matrice carbonée).
Le drainage lymphatique permet libérer les toxines qui contaminent l’organisme. Afin d’obtenir un excellent résultat, les professionnels du massage, à savoir les masseurs et kinésithérapeutes
Véritable allié beauté et santé, le collagène marin constitue un produit phare en soins cosmétique et médecine esthétique. C’est un principe actif présent dans plusieurs
Grossesse
Quand pouvez-vous continuer les tests de bébé après une fausse couche ? Pour vous dire la vérité, il n’y a pas de réponse lisible. Après une
Minceur
Séniors
Maladie
La pilule Adepal existe sous deux formes principales : elle peut se présenter soit dans une plaquette comptant 21 comprimés soit dans plaquette de 28 comprimés.